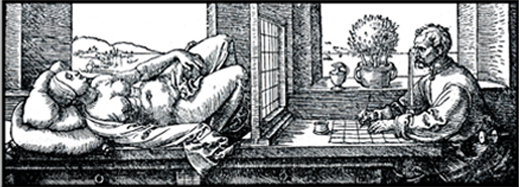Travaux et Mémoires
-
Christaller était membre du parti nazi (NSDAP) Des archives aux « fake news »
Date de publication : 27-09-2023Auteurs :NICOLAS GeorgesAuteurs :RADEFF AnneActivité:professeurs honorairesEn 1989, Mechtild Rössler divulgua que Walter Christaller fut un adhérent du parti nazi (NSDAP) dès le premier juillet 1941, en précisant le numéro de sa carte de membre : 8.375.670 (RÖSSLER, 1989, p. 426, note 17). Depuis quelques temps cependant, cette appartenance est remise en question. Un professeur à la retraite de l’Université de Buenos Aires, Carlos Reynoso, a participé à cette contestation-révision dans une publication mise en ligne en 2019 et 2023 sur différents sites. Or, il est totalement erroné de mettre en doute l’appartenance de Walter Christaller au parti nazi. Les trois documents d’archives allemandes publiés et analysés dans ce texte confirment la divulgation de Mechtild Rössler en 1989.
-
Science et idéologie. Walter Christaller : épistémologie modélisatrice ou principiante ?
Date de publication : 16-10-2019Auteurs :NICOLAS GeorgesActivité:professeur honoraireL’épistémologie modélisatrice reconstruit la pensée de Walter Christaller en lui conférent un rôle scientifiquement « révolutionnaire ». L’épistémologie principiante s’efforce de retrouver sa pensée en évitant les anachronismes et les interprétations a posteriori. La première approche minimise le lien entre la pratique scientifique et l’engagement politique, la science et l’idéologie. La seconde le met en évidence en contextualisant les mots, les idées et les procédures utilisés par Walter Christaller. Le paradigme modélisateur de la géographie quantitative hypothético-déductive de l’analyse spatiale qui voulait « révolutionner » la manière de faire de la géographie en se réclamant de Walter Christaller n’a pas remplacé le paradigme géographique descriptif classique. Il n’a fait qu’ajouter une branche à l’arbre foisonnant des géographies procédant d’une attitude de plus en plus critique à l’égard de Walter Christaller et de son héritage épuré.
-
Fernand Maurette (1878-1937)
Date de publication : 18-12-2016Auteurs :CARRUPT RolandActivité:professeurCette notice biographique propose de redécouvrir un géographe au parcours hors des sentiers battus. Spécialiste de géographie économique qui s’est intéressé très tôt au commerce mondial et aux marchés, Fernand Maurette a passé un quart de siècle à l’Ecole normale supérieure de la rue d’Ulm, en tant qu’étudiant puis au service de l’administration. En octobre 1924, la famille Maurette quitte Paris pour Genève où le géographe est appelé au poste de chef de la Division des recherches du BIT. Le réseau normalien et socialiste a fonctionné, puisque le directeur de l’institution genevoise n’est autre que son condisciple en khâgne et à la rue d’Ulm, l’ancien ministre de l’Armement Albert Thomas. Maurette a toujours été un membre, certes discret mais avéré, du réseau Thomas dont il partageait les idées réformistes. Sur les bords du Léman, le géographe va gravir les marches du BIT dont il deviendra sous-directeur en 1933, tout en continuant à écrire de la géographie (articles, livres et manuels scolaires) en traitant, entre autres, de l’internationalisation de la production et du travail. Il va également s’investir avec son épouse et son beau-père Paul Dupuy dans la création et le développement de l’Ecole internationale de Genève.
-
L’évolution des structures intra-urbaines au Havre des origines à nos jours : Les faits et leur interprétation
Date de publication : 18-02-2016Auteurs :GUIEYSSE Jean-AlbertAuteurs :REBOUR ThierryActivité:GéographesAdresse:jaagui@sfr.fr rebourthierry@orange.frCet article se propose de montrer que les formes et les structures intra-urbaines de l'agglomération du Havre ont évolué selon les trends de la conjoncture économique longue; autrement dit, les mouvements longs du pouvoir d'achat. Nous montrons que, du début du XVIème siècle jusqu’à nos jours, les morphologies internes de l'agglomération semblent bel et bien soumises à la dynamique du partage des richesses. Plus celui-ci est équitable, plus les villes ont une forme proche des modèles néo-classiques d’équilibre, à l'organisation circulaire. Au contraire, plus ce partage est inéquitable et favorise les revenus du capital aux dépens de ceux du travail, plus la forme de la ville s’éloigne de ces structures circulaires pour se rapprocher du modèle radial identifié par Hoyt dans les années trente à Chicago. Dans les années 2000, la Crise et le processus très ségrégatif de la métropolisation, activent vigoureusement cette dernière dynamique.
C'est donc la conjoncture économique qui modèle les villes, agissant sur un héritage doté cependant de l'inertie propre à tout établissement humain.
-
Paysage 1 : Formes et cartographie. Paysage 2 : De la crise à la réversibilité créatrice
Date de publication : 28-10-2015Auteurs :GUIEYSSE Jean-AlbertActivité:maître de conférences à l'Université d'OrléansCes deux articles sont nés de deux interrogations sur les paysages, correspondant à deux temps de la démarche, dissociés pour la commodité de l'analyse.
1. Pourquoi tant de polémiques sur les paysages: qu'est-ce qu'un beau paysage; pourquoi vouloir protéger les "paysages menacés"; inversement, pourquoi, au nom de quoi justifier leur destruction - ou, plus souvent, et c'est plus commode, se résigner à "la fatalité" ?2. Comment peut-on représenter les paysages dans leur extension à la surface de la Terre - c'est-à-dire au moyen d'une carte ?
Résoudre le problème numéro deux permet d'argumenter et réfléchir à la première série de questions. En effet, la cartographie permet d'accéder à un niveau de compréhension global de l'espace géographique et, en l'occurrence, des paysages qui font partie de l'environnement matériel et culturel des hommes-habitants de la Terre. C'est pourquoi cette question qui paraîtrait "technique" au premier abord, est traitée dans le premier article.
2. Le second article est fondé sur cette conception du paysage, comme objet géographique tout d'abord matériel, construit, produit au cours de l'histoire: il analyse les conditions sociales et économiques de cette production. De cette façon, il sera possible de tracer des perspectives, quant à l'évolution des paysages et du cadre de vie, précisément dans un pays "industriel" comme la France, qui fournit les exemples cités au cours du texte.
Pour citer ce texte :
GUIEYSSE, Jean-Albert, "Paysage 1 : Formes et cartographie. Paysage 2 : De la crise à la réversibilité créatrice",
In : Cyberato, Publications, Travaux et Mémoires, octobre 2015 : www.cyberato.org